|
Votre santé n’est pas que l’affaire des blouses blanches, mais d’abord la vôtre. |
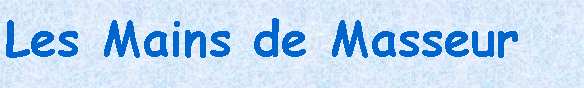



|
Qu’est-ce que l’Ostéopathie ?
Le dictionnaire donne comme définition :
"maladie des os" …ce qui n'est pas très clair ! La loi française, qui va dans un autre sens, parle (dans l'article 372 de la Santé Publique) de : "mobilisation forcée des articulations, réduction des déplacements osseux, manipulation vertébrale et d'une façon générale de tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondilothérapie et de chiropractie".
Tout cela ne correspond pas à l'ostéopathie enseignée et pratiquée officiellement dans les pays anglo-saxons, que le législateur français ramène à une technique de vertébrothérapie, alors qu'il s'agit d'une médecine à part entière. Elle s'appuie sur la même anatomie, les mêmes grands principes de physiologie que la médecine officielle, mais, grâce à une analyse originale de certains éléments délibérément ignorés par d'autres, elle constitue une médecine de l'Homme total, qui apporte de remarquables soulagements à un grand nombre de malades.
PHILOSOPHIE OSTEOPATHIQUE
"Le mouvement, c'est la vie" : le mot "mouvement" doit, ici, être pris dans son sens large, car il ne concerne pas uniquement les rapports de l'individu avec son environnement, mais englobe également ses propres structures, tant macroscopiques que microscopiques.
Une restriction de mobilité, partielle ou totale, d'une quelconque de ces structures, retentira sur le fonctionnement de cette structure, en premier lieu, mais également, du fait de l'unité fonctionnelle, sur les autres structures et fonctions.
Un médecin américain, Andrew Taylor STILL (1828-1917), a été le fondateur de cette philosophie. A une époque où l'endocrinologie n'était pas encore née, et où les connaissances physiologiques étaient encore assez rudimentaires, il bâtit une médecine différente, dont certains principes ne peuvent être vérifiés que de nos jours, grâce aux progrès techniques enregistrés depuis lors.
Très schématiquement, cette philosophie ostéopathique peut être résumée en 3 grands principes fondamentaux :
Premier principe : STRUCTURES ET FONCTIONS SONT LIÉES - Les structures sont l'ensemble des tissus de soutien de l'organisme, c'est-à-dire os, muscles, ligaments, tendons, mais également les fascias1.
- Les fonctions sont les charges dévolues aux différents systèmes qui oeuvrent dans deux buts principaux : sauvegarde de l'individu (fonction respiratoire, nutritive, locomotion, fonction nerveuse et psychique, etc), et sauvegarde de l'espèce (fonction de reproduction).
- Pour son fonctionnement normal, l'organisme a besoin de la cohésion totale des structures et des fonctions. Une des idées originales de STILL a été de montrer que toute atteinte d'une structure ou d'une fonction retentit en premier lieu sur elle-même, mais, également, par extension dans l'espace et dans le temps, sur les autres structures et fonctions. Ainsi, une atteinte articulaire peut, par déséquilibre mécanique et par voie nerveuse réflexe ou endocrinienne, retentir sur toutes les fonctions. Autre possibilité, un problème psychique peut par différentes voies, nerveuse, endocrinienne, conduire à des troubles mécaniques au niveau musculaire puis articulaire. 1 (fascias) : membranes aponévrotiques qui réunissent plusieurs segments du corps, permettant un équilibre des tensions mécaniques, et servant aussi de support de transmission aux différents circuits énergétiques qui parcourt l’organisme.
Deuxième principe : UNITÉ FONCTIONNELLE - Il découle du principe précédent, puisque toute atteinte d'une structure ou d'une fonction se répercute sur les autres. Un organisme n'est pas l'assemblage de deux poumons + un cœur + un estomac… oeuvrant isolément, mais ceux-ci constituent les différents composants d'un tout. Ce raisonnement conduit l'ostéopathe à ignorer la maladie pour s'occuper du malade.
Troisième principe : L'organisme POSSEDE en lui-même LES MOYENS DE SE GUERIR - Notre organisme est conçu de telle sorte qu'il puisse faire face aux agressions de toute nature qui l'assaillent. Il ne devient vulnérable que si ses fonctions de défense sont perturbées et, d'après les deux principes précédents, les perturbations pourront être créées si une quelconque des structures ou fonctions est déséquilibrée. Le fait de ré-harmoniser, donc de normaliser les causes de déséquilibre, replacera l'organisme dans une position telle qu'il pourra à nouveau lutter pour revenir à l'état de santé.
Andrew Taylor STILL et ses élèves, en particulier William Garner SUTHERLAND, ont ainsi jeté les bases, d'une thérapeutique s'adressant à une entité, l'HOMME.
TECHNIQUE
Les traitements viseront à supprimer les restrictions de mobilité, afin de redonner à l'organisme sa liberté de manœuvre pour lutter contre ses agresseurs. La cause des troubles étant supprimée, les troubles secondaires, qui étaient induits par cette lésion primaire, vont aussi disparaître.
Quelques définitions indispensables :
Lésion ostéopathique : Raymond RICHARD (auteur de nombreux ouvrages sur l'ostéopathie), la définit comme une restriction totale ou partielle de mobilité de deux segments articulaires, à même de conditionner la vascularisation et de perturber le fonctionnement du système nerveux autonome. La lésion ostéopathique amène une perturbation structurelle qui, elle-même, engendre des perturbations circulatoires et nerveuses qui amèneront, dans le temps, des perturbations fonctionnelles. Il faut donc traiter la structure pour améliorer la fonction.
Lésion primaire : Lésion initiale d'une structure, qui va déterminer, par sa restriction de mobilité, des perturbations dans les fonctions de cette structure et, de loin en loin, retentir sur les autres. Cet enchaînement de phénomènes lésionnels, lésions primaires, lésions secondaires, est appelé "suite mécanique".
Lésion secondaire : Atteinte touchant d'autres structures que celles qui ont été initialement touchées, et qui sont causées par les déséquilibres dus à la lésion primaire.
L'objectif d'un traitement ostéopathique sera donc la chasse à la lésion primaire, les lésions secondaires se corrigeant quelquefois, sans intervention directe.
Les 3 GRANDS SECTEURS de l’OSTEOPATHIE
Il existe 3 grands secteurs en ostéopathie, qui ne sont pas séparés puisque la lésion de l'un peut retentir sur les autres.
1) OSTEOPATHIE PARIÉTALE C'est la plus connue, qui est le plus souvent confondue avec la vertébrothérapie ou avec les techniques de rebouteux. Le but du traitement ostéopathique est de redonner à toutes les articulations leur mobilité physiologique initiale. La restriction de mobilité peut être causée par un traumatisme direct, (entorse de cheville, etc), ou par un spasme musculaire réactionnel. Celui-ci se produit lorsqu'une articulation exécute un mouvement rapide ou forcé. Le dispositif musculaire qui est destiné à la protéger peut alors être pris en défaut lorsqu'elle atteint ses limites physiologiques. Il se spasme alors, et tend à figer l'articulation dans cette position, empêchant son retour en arrière. Ainsi se crée une lésion primaire qui, par les déséquilibres qu'elle provoque, va pouvoir déterminer des lésions secondaires dans les autres structures ou fonctions.
Prenons un exemple caractéristique : celui du sacrum2. Dans les activités de la vie courante, celui-ci oscille autour des ailes iliaques grâce aux articulations sacro-iliaques. Il arrive fréquemment qu'une restriction de mobilité se produise au niveau de l'une de ces deux articulations. Cela peut entraîner une cascade de lésions secondaires :
- Répercussion sur le plan vertébral : Le sacrum sert de base à l'échafaudage des vertèbres. S'il se met en torsion, il entraîne automatiquement une compensation au niveau des vertèbres lombaires, puis d'autres étages vertébraux (dorsal, cervical) pourront suivre afin de maintenir l'équilibre des lignes de force de la colonne et le regard horizontal. Ce sont ces douleurs vertébrales qui, amèneront le sujet à consulter alors que la lésion primaire, celle du sacrum, restera muette. Si la correction se limite au niveau vertébral, elle ne sera en aucun cas définitive.
- Répercussion vers le bas : En premier lieu, il faut citer les problèmes de pincement des nerfs rachidiens au niveau des trous de conjugaison, à la suite de blocage ou de restriction de mobilité vertébrale, d'où l'origine de certaines sciatiques. L'aile iliaque, du côté de la restriction de mobilité, va se déplacer par rapport au sacrum, déterminant une inégalité apparente de longueur des membres inférieurs. Ceci entraîne un déséquilibre des axes mécaniques, qui va provoquer des douleurs au niveau des genoux, de la cheville, des déformations des voûtes plantaires et, à la longue, des phénomènes d'arthrose. La correction de la lésion primaire sacro-iliaque fera disparaître les douleurs au niveau des genoux et de la cheville, sans intervention directe et évitera l'apparition ultérieure du phénomène rhumatismal dégénératif.
- Perturbations viscérales : Elles apparaissent particulièrement chez la femme, où le sacrum est relié à l'appareil gynécologique par un système ligamentaire important. Toute restriction de mobilité du sacrum retentira donc sur l'appareil gynécologique, et inversement.
- Perturbations au niveau crânien : Le sacrum est relié directement à l'occipital3, par un lien inextensible, la dure-mère4, qui ne possède aucune attache intermédiaire au niveau vertébral. Toute restriction de mobilité de l'un des deux os extrêmes entraînera, forcément, des perturbations dans la mobilité de l'autre. Il est ainsi possible d'expliquer un certain nombre de céphalées, simplement par une restriction de mobilité du sacrum. A l'inverse, une lésion récidivante du sacrum, sans cause apparente, pourra, simplement, être due à un blocage au niveau de l'occipital.
2 (sacrum) : os central du bassin, articulé avec les deux os latéraux iliaques. 3 (occipital) : os postérieur de la base du crâne. 4 (dure-mère) : partie périphérique des méninges, emballant et protégeant le système nerveux.
Le TRAITEMENT : Comme préalable à tout traitement, il comprendra tout d'abord un interrogatoire et un examen ostéopathique du sujet qui, grâce à des tests de mobilité précis, comparatifs entre le côté sain et le côté lésé, permettent de mettre en évidence une ou plusieurs restrictions de mobilité. La palpation est, obligatoirement, très précise, et les perceptions extrêmement fines, car les autres moyens de recherche ne peuvent remplacer les sensations tactiles des structures en mouvement. Le bilan doit être complet, et ne doit pas se limiter au secteur dont souffre le malade car la lésion primaire est souvent ailleurs.
La NORMALISATION : Il existe 4 catégories de techniques correctives. Le choix de l'une ou de l'autre étant fait en fonction du sujet, en particulier de son âge, de la lésion et, surtout, de l'affection du thérapeute pour telle ou telle manœuvre.
a) Les techniques directes Le praticien repositionne par un appui direct les segments en lésion. Le sujet doit être détendu, d'où la nécessité d'un très bon contact praticien-patient. Dans un premier temps, les tissus mous sont travaillés avec une technique de type neuromusculaire, afin de réduire les tensions autour de l'articulation en lésion. Dans un deuxième temps, les segments sus et sous-jacents à la lésion sont verrouillés. Cette mise en tension étant maintenue, l'ostéopathe, d'un mouvement rapide mais de très faible amplitude, repousse le segment en lésion pour le ramener dans sa position physiologique. C'est le trust ostéopathique.
b) Technique myotensive On utilise ici le réflexe d'inhibition réciproque, qui permet de mettre en jeu des groupes musculaires antagonistes qui vont, d'eux-mêmes, corriger la lésion. Une contraction statique de leurs antagonistes permet d'inhiber le spasme des groupes musculaires maintenant l'articulation en lésion. Profitant de ce relâchement, l'ostéopathe augmente la mise en tension au niveau de l'articulation, dans le sens de la correction, et la ramène ainsi dans son amplitude physiologique.
c) Technique respiratoire Ce principe de correction, très élaboré, et d'une grande douceur d'application, le rend très utile pour le traitement, en particulier des sujets aux os fragilisés : les personnes âgées. Sa mise au point est due à William Garner SUTTERLAND, et met en jeu les fascias qui sont ces membranes aponévrotiques qui, au sein de l'organisme, ont différents rôles à jouer et, en particulier, une action de répartition des tensions mécaniques. Leur sollicitation, selon des techniques spécifiques, assure un rééquilibrage de ces tensions et, par la même, une correction des lésions ostéopathiques. Il n'y a pas d'effort mécanique direct, les doigts du praticien ne servant ici qu'à guider le mouvement correcteur. Paradoxalement, dans un premier temps, les tensions des fascias sont sollicitées dans le sens de l'aggravation, cette surtension entraîne une réaction des fascias en sens inverse, ce qui va leur permettre de rétablir la mobilité normale du segment en lésion. Un deuxième temps permet de stabiliser la correction. L'orientation donnée par les doigts du praticien est, cette fois-ci, le sens correcteur. Le sujet doit maintenir une apnée, soit inspiratoire, soit expiratoire, selon le sens que le praticien désire donner à sa manœuvre.
d) La technique de JONES Un médecin américain contemporain, Laurence H. JONES, a basé sa technique sur des points douloureux et des positions qui les font disparaître. Des points douloureux (points trigger), au niveau de la peau ou sous cutanés, sont spécifiques d'une lésion ostéopathique, et correspondent à l'irritation du système neuromusculaire bloquant l'articulation en lésion. Une articulation en lésion peut toujours aller dans le sens de l'aggravation, mais elle ne peut pas se corriger d'elle-même. L'idée originale de JONES a été de placer l'articulation dans le sens de l'aggravation de la lésion, position confortable pour le patient, de maintenir cette position pendant au maximum 2 minutes, ce qui fait disparaître le point trigger, désamorce le système neuromusculaire, et permet, par un retour lent à une position neutre, de ramener l'articulation à sa position physiologique. En aucun cas le mouvement correctif, qui va lever le blocage articulaire, ne repousse l'articulation au-delà de son amplitude physiologique, mais, au contraire, la ramène dans cette amplitude.
2) OSTEOPATHIE VISCERALE Les organes sont doués d'une motilité5 liée à leur physiologie, et d'une mobilité dans l'organisme puisque leur volume va varier en fonction de facteurs tels que l'alimentation, la grossesse, ainsi que leur position qui va varier en fonction des mouvements de l'individu ou de sa façon de se tenir. Il n'est donc pas possible de situer avec la même précision la position des organes et celle des os. Ce sont donc la motilité et la mobilité des organes qu'il faudra tester.
Aussi bien dans le domaine viscéral que gynécologique, les organes sont reliés aux structures osseuses, ou encore entre eux, par des ligaments, des tabliers, etc. Il est possible après examen précis, à l'aide de manœuvres appropriées, de redonner une mobilité satisfaisante aux viscères ou de lutter contre les ptôses. Les pédicules vasculo-nerveux seront en meilleure position, et la fonction des organes se trouvera améliorée. Les réactions inflammatoires, et donc la douleur, disparaissent. On peut ainsi lutter contre les ptôses6, ou réduire une hernie hiatale, lutter contre la constipation, les problèmes gynécologiques, etc. 5 (motilité) : mouvement rythmique propre à l’organe. 6 (ptôses) : descente pathologique des organes.
3) OSTEOPATHIE CRANIENNE Ce chapitre, plus mal connu, est objet de critiques non objectives de la part de ceux qui veulent en ignorer les principes.
Le père de cette technique, William Garner SUTTERLAND, l'a conçue en examinant l'orientation des surfaces articulaires des différents os du crâne, et en l'expérimentant sur lui-même pendant de nombreuses années avant de publier ses travaux vers 1920. Les surfaces articulaires des os du crâne et de la face sont placées de telle façon qu'elles autorisent un déplacement relatif de chacun d'eux, selon des axes très précis. Ces mouvements sont parfaitement perceptibles manuellement avec un minimum d'entraînement. Ils s'effectuent selon un rythme indépendant des rythmes cardiaque ou pulmonaire, et se situe entre 10 et 14 cycles par minute. Chaque cycle comporte une période dite de flexion ou d'inspiration, correspondant à l'augmentation du diamètre transversal crânien et une diminution des diamètres antéro-postérieur et vertical. L'extension, ou expiration, produit les effets inverses, et l'on a pu ainsi comparer ces mouvements à la respiration thoracique, d'où son nom de « respiration primaire ». Elle commence avant la naissance, et ne s'éteint, environ, qu'un quart d'heure après la mort.
Des contraintes anormales, subies par le crâne d'un enfant lors de sa naissance, pourront entraîner des lésions ostéopathiques crâniennes et, plus tard, des répercussions dans différents domaines.
Un segment osseux important est associé à ces mouvements crâniens : le sacrum. Il tend à se verticaliser lors de l'inspiration et à s'horizontaliser lors de l'expiration. Toute la colonne est influencée, et tend à réduire ses courbures dans le premier temps, et à les accentuer dans le deuxième temps.
Cette respiration primaire est également palpable sur l'ensemble du corps, sous la forme d'une onde périodique que l'on a pu comparer au flux et au reflux de la marée.
D'OÙ PROVIENT CE MOUVEMENT ? Il est produit, en premier lieu, par le déplacement du liquide céphalorachidien (LCR), qui naît au niveau des ventricules cérébraux qu'il traverse successivement. Il peut s'en échapper au niveau des nerfs rachidiens, et gagner ainsi le milieu intérieur. Il semble que la pulsation qui met en mouvement le LCR soit due à une contraction des masses cérébrales sous l'action des cellules gliales, qui sont de même origine embryonnaire que les cellules cardiaques, et douées, comme elles, d'autorythmicité.
Au repos, pendant le sommeil, les cadences respiratoires thoracique et crânienne sont synchrones. Un problème nerveux, la fatigue, vont ralentir ces mouvements, dont la cadence doit être mesurée, comme celle du pouls ou de la respiration thoracique. Les pulsations rythmiques des centres nerveux ont donc 2 actions : - Première action : pulsation du LCR à travers le circuit décrit plus haut. - Deuxième action : mobilisation des os de la boîte crânienne et de la face, ainsi que du sacrum.
Un système de fascias, appelé tendon central du corps, relie les os de la boîte crânienne aux organes thoraciques et abdominaux. Ils sont ainsi en liaison mécanique et énergétique avec toute la partie crânienne.
Les fibres creuses qui constituent le tissu conjonctif des fascias servent de minuscules tuyauteries pour conduire le LCR vers l'ensemble des organes du corps.
TECHNIQUE DE L’OSTÉOPATHIE CRÂNIENNE : L'examen ostéopathique crânien permet d'apprécier les restrictions de mobilité des os de la boîte crânienne, de la face et du sacrum. A l'aide de manœuvres précises, spécialement adaptées à la faible amplitude du mouvement respiratoire primaire, on peut apporter des corrections aux restrictions de mobilité. Ces techniques permettent de régler de nombreux problèmes dans lesquels sont impliqués les os du crâne, de la face, et qui, à distance, créent des perturbations qu'une thérapeutique locale ne pourrait traiter. Une restriction de mobilité de l'occipital ou du sphénoïde 7, peut entraîner une perturbation de fonctionnement de l'hypophyse qui dirige tout le système hormonal.
Le LCR a un rôle vital dans l'organisme, que les ostéopathes avaient deviné au siècle dernier, mais que les physiologistes actuels ne font que confirmer. Outre son rôle hydraulique protecteur du système nerveux, il est également vecteur de nombreuses hormones, des neurotransmetteurs, et contribue à l'évacuation des déchets du métabolisme nerveux.
L'ostéopathie crânienne aura donc son rôle à jouer dans des perturbations aussi diverses que l'asthme, la migraine, les perturbations de l'équilibre nerveux, les instabilités vertébrales ou sacrées, par la suite de la liaison entre occipital et sacrum. Une restriction de mobilité dans une quelconque des articulations des os du crâne, entraînera une instabilité, ou une autre restriction de mobilité dans toute l'organisation crânienne et faciale. Les conséquences seront donc innombrables. On pourra avoir des répercussions sur la dentition, sur le plan respiratoire, des sinusites, etc. 7 (sphénoïde) : os de la base du crâne articulé avec l’occipital.
RESULTATS
Comme toute médecine, l'ostéopathie ne peut prétendre être une panacée. Cependant, elle fait partie des médecines douces et naturelles. La main du thérapeute n'est pas agressive, mais la technique employée dans les règles de l'art, peut, à la limite, ne pas apporter ce que souhaite le malade, mais en aucun cas l'aggraver. Compte tenu du fait que les malades arrivent chez l'ostéopathe après avoir vainement essayé de multiples autres traitements, le pourcentage de réussite semble supérieur à celui d'autres thérapeutiques.
Pour une sciatique, par exemple : les antalgiques, les anti-inflammatoires, voire le corset plâtré, s'attaquent aux effets, mais ne traitent pas les causes. La lésion primaire à l'origine de cette algie n'est que rarement purement vertébrale. Elle peut, en effet, être reliée à des problèmes de statique du bassin, à des problèmes musculaires, à des problèmes viscéraux ou gynécologiques, pouvant retentir directement sur le sacrum. Cette énumération (non exhaustive) permet de comprendre pourquoi la chirurgie, qui ne s'attaque qu'au disque vertébral, ne donne des résultats intéressants qu'une fois sur deux.
Autre exemple : l'entorse de cheville, si souvent plâtrée actuellement. Ce temps d'immobilisation, auquel s'ajoute la gêne, voire la douleur qui lui succède, sont des plaies pour le budget de la Sécurité Sociale, entre autres. L'ostéopathie, en cas d'entorse simple (sans atteinte du ligament), donne des résultats spectaculaires. Le sujet peut, le plus souvent, reprendre dès le lendemain son travail.
L'ostéopathie est une médecine de l'Homme TOTAL.
Elle ne considère pas la maladie, mais l'homme qu'elle vise à rétablir dans son équilibre physiologique, pour que l'organisme puisse, lui-même, mettre en œuvre ses possibilités de traitement. L'ostéopathe ne considère donc les maladies portant un nom que comme symptômes et comme moyen de communication avec le malade, habitué à connaître le nom de sa maladie. L'ostéopathie a ses indications (qui sont vastes), et ses limites.
L'OSTEOPATHIE en FRANCE
Il y a quelques années, l'ostéopathie n'existait pas officiellement en FRANCE. Son exercice était réservé aux médecins, à qui elle n'était pas enseignée. Certains précurseurs, pour la plupart des paramédicaux, ont eu le courage d'aller à l'étranger, en AMERIQUE, en ANGLETERRE, en SUISSE, principalement, pour suivre des cours que les écoles d'ostéopathie de ces pays ouvraient également aux étrangers, afin d'obtenir un diplôme ne possédant pas d'équivalant français.
Depuis, une école d'ostéopathie s'est ouverte à BOBIGNY, qui est uniquement, pour l'instant, réservée aux médecins. Pour les paramédicaux français, un certain nombre de fondations, d'instituts, d'académies privées, créées par des ostéopathes titulaires de diplômes étrangers, assurent, par séminaires successifs répartis sur une période allant de 3 à 5 ans, une formation complète d'ostéopathe, sanctionnée par l'obtention d'un diplôme, malheureusement non officiel.
Vis-à-vis de la Sécurité Sociale, les traitements ostéopathiques ne sont pas remboursés lorsqu'ils sont pratiqués par des non-médecins. Par contre, le fisc est beaucoup plus large d'esprit, et admet parfaitement que l'on puisse être ostéopathe, au même titre que cartomancienne, rebouteux ou péripatéticienne.
(Résumé d'un article de Serge LAPIERRE, publié dans "Le masseur-kinésithérapeute aveugle" en 1984) |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Réalisation : Les Mains de Masseur — Copyright © 2006-2013 Les Mains de Masseur.fr (Tous droits réservés) Site optimisé pour voyants et non-voyants (compatible synthèse vocale JAWS) |